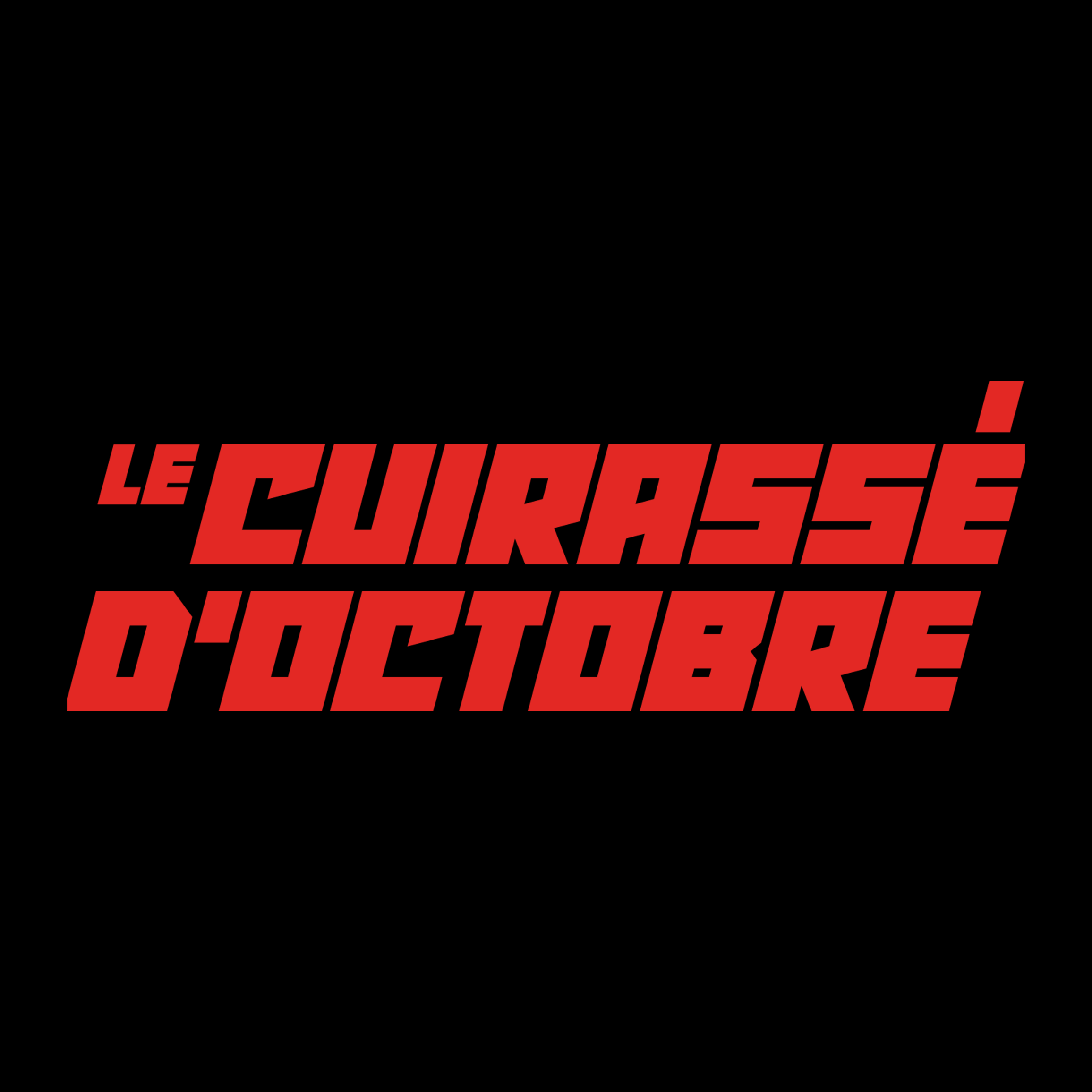Après les monstres, nous allons nous tourner vers une autre figure incontournable du cinéma d’horreur : le fantôme.
Etape obligatoire, la définition : il s’agit d’un mort n’ayant pas trouvé le repos et qui apparaît dans le monde des vivants. Son enveloppe matérielle n’est pas montrée et il est rarement en état de putréfaction contrairement aux zombies. Très souvent transparent, le fantôme peut se déplacer dans l’espace-temps à sa guise. Le revenant est un proche ou un inconnu, il garde cet aspect étrange, cette singularité qui lui donne un air inquiétant. Il reflète notre propre mort qui doit venir un jour.
Le fantôme n’est pas toujours une menace ; il arrive très souvent qu’il soit amical ou positif pour les personnages, comme la jeune fille assassinée de Lovely Bones de Peter Jackson, le mari disparu qui souhaite régler ses dernières obligations sur Terre avant d’aller dans l’au-delà dans Vers l’autre rive de Kiyoshi Kurosawa, les fantômes de Poudlard ou ceux de Crimson Peaks de Guillermo Del Toro venant prévenir l’héroïne du danger. Dans le cinéma horrifique, ce sera surtout les spectres malveillants, ceux avec une bonne raison de s’en prendre au vivant.
Dans les histoires de fantôme, il y a toujours une idée de vengeance posthume contre un crime ou une injustice commise contre l’esprit durant son vivant. Dans le théâtre du kabuki, un théâtre japonais populaire, le fantôme d’Oiwa de la pièce Tôkaidô Yotsuya Kaidan est un célèbre exemple. Elle est l’épouse d’un samouraï ambitieux, Lemon, qui la défigurera puis l’assassinera afin de se remarier. Oiwa reviendra hanter son meurtrier et le poussera à assassiner sa nouvelle femme, avant que le samouraï ne soit tué par la sœur adoptive de son fantôme d’ex-femme. Oiwa fait figure de justicière d’outre-tombe pour les péchés non réparés. Autre figure du théâtre japonais, le fantôme de la Femme-chat, à mi-chemin entre esprit vengeur et vampire. Celle-ci représente les victimes d’un seigneur féodal. Dans l’adaptation de Nobuo Nakagawa, La maison du fantôme de la femme-chat (1958), celle-ci vient d’abord tuer la mère, puis le fils et enfin le seigneur qui a assassiné son enfant avant de la violer, mais aussi poursuit les descendants du serviteur du seigneur, car il a aidé ce dernier à maquiller l’homicide. Dans Poltergeist (1982) de Tobe Hooper, un promoteur immobilier sans scrupule fait construire des maisons pour classe moyenne au-dessus d’un cimetière sans en avoir fait partir les corps. Kayako Saeki, la célèbre figure de Ju-On, est lâchement assassinée par son mari jaloux en même temps que son fils et vient porter sa souffrance par-delà la mort. Seulement, contrairement aux précédentes figures citées, Kayako ne se limite pas à se venger de certains individus, mais vise l’Humanité elle-même comme responsable de ses malheurs.

Par sa fonction de résurgence d’un passé d’injustice, le fantôme peut permettre d’émettre une critique sociale. Hanako est au départ une légende urbaine apparue au Japon dans les années 70-80 au sein des écoles japonaises. Elle est dite habillée de rouge et fait mourir de peur lors de ses apparitions dans les toilettes. Son existence vient d’une rumeur, mais sa légende aura droit à des adaptations en BD, en série ou en film[1]. Son importance sociale est résumée dans l’ouvrage Fantômes du cinéma japonais de Stéphane du Mesnildot :
« Hanako est un monstre organique mais aussi un spectre social. Le collège est l’un des premiers lieux d’intégration pour l’enfant mais c’est aussi le théâtre de la triste pratique de l’ijme – l’exclusion et la persécution d’un enfant, parfois par une classe entière. Hanako, victime de l’ijme qui se serait suicidée, perpétue la tradition revancharde des spectres classiques comme Oiwa. Les toilettes sont par ailleurs un lieu d’eau insalubre que l’on peut rapprocher des étangs méphitiques des anciennes légendes. »
Dans Whispering Corridors (1998) du coréen Park Ki-hyeong, le système éducatif, cette fois hors du Japon, est à nouveau dénoncé. L’éducation basée sur la compétition, les brimades et les châtiments corporels est critiquée à travers un fantôme qui se déguise en lycéenne tous les 3 ans pour se venger des professeurs et des élèves tortionnaires.
Le spectre se loge souvent dans une demeure bien spécifique, dans bien des cas le lieu de sa mort. Dans la série Amityville, les esprits interviennent pour pousser la famille occupant la maison à bout. La maison du diable (1963) de Robert Wise montre le personnage d’Eleanor finir par hanter la maison dont elle tentait de s’échapper[2]. Ce thème de la demeure hantée est très ancien, nous en avions déjà parlé dans le cadre de la littérature gothique anglaise, notamment dans le roman fondateur Le château d’Otrante d’Horace Walpole. Dès fois le lieu hanté est plus indistinct. Dans Ring d’Hideo Nakata, Sadako hante la cassette maudite et les appareils électriques.
Se pose la question de l’origine du fantôme : vient-il d’un univers parallèle, ce qui entraine qu’une fois mort il n’y a plus lien possible avec les vivants, ou constitue-t-il une prolongation du vivant ? Selon ce dernier point de vue, le fantôme peut rapidement devenir le symbole d’un individu isolé ou dont la liberté est aliénée. Il devient alors une métaphore de notre vivant, du fait que nous agissons déjà de manière automatique, que nous sommes déjà morts. Dans le cinéma social japonais, il n’est pas rare de retrouver des individus réduits à être des fantômes de la société par une dépersonnalisation à outrance. Dans The Rebirth (2007) de Masashiro Kobayashi, où deux parents face au deuil sont laissés dans leur douleur sourde à répéter chaque jour les mêmes gestes. Dans Tokyo sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa, ce sont les hordes de chômeurs qui deviennent eux-mêmes des fantômes. L’incapacité à différencier entre humain et fantôme peut arriver, comme dans Kaïro de Kurosawa[3], de la famille dans Les autres (2001). En forçant le trait, car on peut le comprendre en creux sans que cela soit dit explicitement, c’est que c’est le capitalisme lui-même qui nous transforme en fantôme, à force de nous faire pratiquer un travail répétitif, de nous isoler économiquement et socialement les uns des autres, malgré des connexions plus simples en apparence, notre position de producteur consommateur ou de non-consommateur nous métamorphose en étranger à nous-même et aux autres, et nous devenons fantôme à notre tour.
Le fantôme a déjà connu des utilisations politiques. Dans A petal (1996) de Jang Sun-woo, il est question du massacre de Kwangju du 18 mai 1980, dans le cadre de la répression d’un soulèvement populaire contre la dictature au pouvoir en Corée du Sud, qui a ensuite imposé une chape de plomb sur cette histoire. Le fantôme est ici une victime de ce massacre qui vient rappeler l’horreur de ce qu’on a tenté de faire oublier. D’ailleurs l’héroïne était petite fille au moment du drame. Dans Carne de tu carne (1983) de Carlos Mayolo, ce sont les fantômes des ancêtres exploiteurs de deux jeunes bourgeois de Colombie qui les condamnent à se nourrir du peuple pour survivre. De façon moins ouvertement politique, on a dans Poltergeist la remise en cause de l’organisation familiale traditionnelle. Sans grande subtilité, entre le père lisant Reagan le soir, l’hymne américain utilisé comme générique (sous-entendu que le rêve se réalise au détriment d’autrui) et la mère qui éclipse totalement le père comme rôle central de la famille.
A la manière de la nouvelle Le Horla de Maupassant, le spectre permet de questionner la perception de la réalité. Dans Les innocents de Jack Clayton (1961), nous savons dès le début de l’intrigue que nous allons être dans le fantasme de la nourrice (elle avoue qu’elle ne peut « s’empêcher d’imaginer certaines choses »). C’est par des petits sous-entendus ou des expressions que la nourrice commencera à perdre pied, sans lui faire comprendre la réalité derrière l’étrangeté du comportement des enfants (le désamour familial de la part de leur oncle, le traumatisme d’avoir perdu deux figures parentales de substitution), et lui faire croire que deux fantômes vont prendre le corps des enfants. Cette obsession prend corps par des scènes de juxtaposition où nous la retrouvons couchée au lit tandis que les images des enfants défilent devant elle. La musique stridente vient renforcer le cauchemar qu’elle vit mais aussi nous fait comprendre qu’il s’agit justement d’un rêve éveillé. C’est par ailleurs son éducation rigoriste, que l’on devine en creux du long-métrage, qui la pousse à croire au démon et à refouler aussi ses pensées, en l’espèce le désir charnel. Jusqu’à devenir une plus grande menace que les soi-disant « fantômes ».

Dans une certaine mesure, le cinéma progressiste à la possibilité de s’emparer de la figure du fantôme, en tant que représentant d’un passé qui refait surface. Si on voulait aller au bout de cette logique, le fantôme deviendrait le symbole de l’exploitation, de la traite négrière, de la colonisation, du massacre des pauvres, etc. On pourrait bien voir les fantômes de la Commune venir hanter les descendants des Versaillais ! Les décoloniaux qui tentent de faire ressurgir dans la mémoire collective les crimes bien réels de la colonisation pourraient réaliser ce genre d’expérience, avec par exemple les torturés de la guerre d’Algérie revenant hanter les membres de l’OAS, ou encore les morts de la Shoah envers les nazis ou leurs adeptes. En réalité, à cause de ce retour du refoulé, les questions sociales sont potentiellement même plus faciles à traiter dans le cadre d’un film de fantôme que dans le cadre d’un film sur un monstre. Attention, je ne dis pas qu’un film de fantôme a automatiquement une portée progressiste. Dès fois, le spectre sert à justifier les croyances en l’au-delà des personnages tandis que les rationalistes sont moqués. Il existe dans tous les cas un vrai terreau d’utilisation du spectre dans un point-de-vue social.
[1] Notamment Hanako-chan (1998) de Tsutsumi Yukihiko.
[2] Voir Vie des fantômes de Jean-Louis Leutrat.
[3] Voir notre critique de ce film, « Kaïro : solitude mortelle au pays des fantômes ».