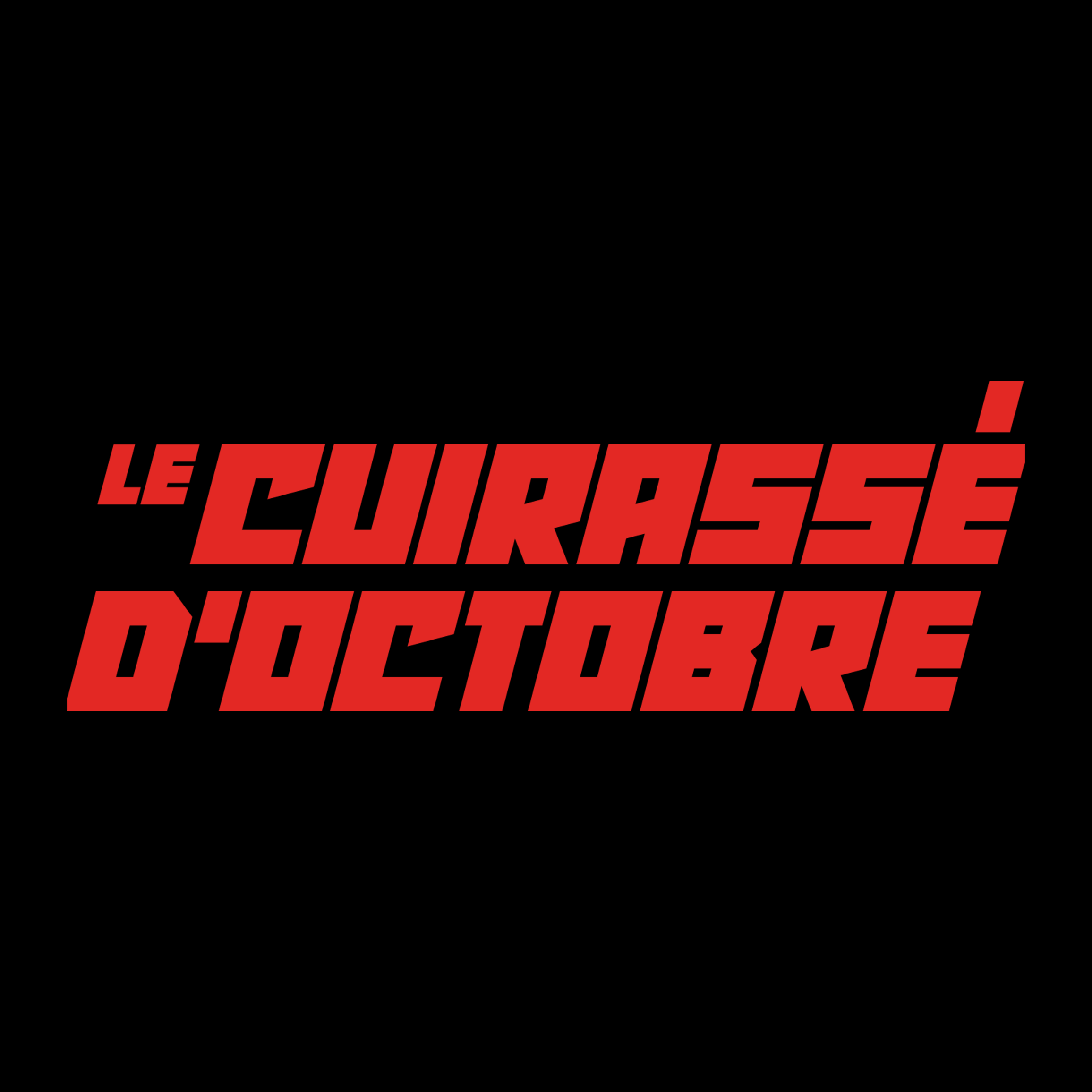Aujourd’hui, chers lecteurs, j’ai cherché à vous faire découvrir l’un des chefs d’oeuvres du cinéma documentaire et du cinéme militant. Un film qui m’a profondément marqué, autant que la personnalité de son réalisateur René Vautier : Afrique 50.
Vous trouverez deux textes sur ce film trouvés sur internet (pour accéder à l’article original, il faut cliquer sur le titre). Le premier vient du blog des Jeunes pour la Renaissance Communiste en France, le second du blog T’en poses des questions. J’espère que ces deux textes vous donneront l’envie de découvrir plus généralement le cinéma de l’ami Vautier.
AFRIQUE 50 : MONTRER LA RÉALITÉ COLONIALE POUR LA COMBATTRE
/image%2F1193323%2F20210301%2Fob_e4b16f_unknown-26.png)
« Prolétaires de tous les pays, opprimés du monde entier, unissez-vous ! »
Congrès de Bakou, 1920.
Il y a à peine un siècle, la France et l’Angleterre possédaient la moitié de la planète. L’Afrique et l’Asie étaient quasiment partout conquis par les deux nations européennes avec quelques Etats se partageant les restes, à l’instar de l’Allemagne et du Japon. Ce système qu’on appelait colonisation consistait en un contrôle des territoires par une puissance étrangère dans le but de récolter les nombreuses ressources et d’exploiter une main d’œuvre pas chère. Derrière cet objectif concret de la colonisation, il y avait une autre vocation plus affichée que concrétisée celle d’éduquer les peuples dans un « devoir de civilisation de l’homme blanc » comme le disait Jules Ferry. La colonisation s’est caractérisée par un pillage généralisé de l’Afrique et de l’Asie par les colonisateurs. Cette expérience terrible est faite de nombreux massacres dont l’un des plus ignobles a été commis de la main du roi des Belges, Léopold II, sur sa « propriété personnelle » le Congo !
Bien que les mouvements de libération nationale dans les territoires contrôlés par la France, sous l’égide du Parti communiste français, commencèrent leur expansion avant la seconde guerre mondiale, c’est vraiment après la victoire sur la barbarie nazie que ceux-ci se développèrent. Il faut bien comprendre le choc qu’a été la seconde guerre mondiale : un pays d’Europe, l’Allemagne, appliquait explicitement un processus de colonisation aux autres peuples européens, en s’inspirant directement de l’expérience anglaise et française ! Il n’était plus possible pour les européens ou pour les colonisés de se voiler la face sur le pouvoir colonial. A partir des années 40, les peuples se réveillent : l’Indochine triomphe, l’Algérie finit par vaincre, le Maroc et la Tunisie deviennent indépendants, le Mali aussi, le Cameroun se bat durement contre le pouvoir colonial français, etc.
Cette présentation faite du contexte, venons-en à notre sujet. Le processus de décolonisation s’est réalisé au même moment où le cinéma se développait. Les cinéastes militants étaient nombreux des années 30 jusqu’aux années 80, filmant les grèves, la vie des ouvriers pour dénoncer les conditions de travail, le danger de la guerre, le fascisme, etc. Il a donc été question un moment de filmer la problématique coloniale pour la dénoncer puis, plus tard, pour accompagner les luttes de libération nationale. Même si globalement les productions cinématographiques produites à cette époque sur la situation coloniale faisaient plutôt la part belle à une glorification de la colonisation, des œuvres dénonçant l’attitude coloniale ont existé. L’un des exemples le plus parfait est le film Afrique 50 et son auteur René Vautier.
Cinéaste principalement versé dans le documentaire, sans toutefois dédaigner la fiction, René Vautier fut aussi un militant de tous les instants sur les diverses causes comme les conditions de travail en France et les grèves, la colonisation, le racisme, l’apartheid, le féminisme, les essais nucléaires en Polynésie française, l’écologie ou encore le régionalisme breton. A 16 ans il entra dans la Résistance et participa à des combats armés. Il était celui qui lisait des poèmes d’Eluard à ses camarades de luttes. Ceux-ci l’ont obligé à faire des études de cinématographie à l’Institut des Hautes études cinématographique (IDHEC) afin qu’il puisse montrer la réalité telle qu’elle est. Décoré de la Croix de guerre, il réussit les concours et devint cinéaste. C’est dans ce cadre-là qu’il réalisera Afrique 50 son premier film. A la suite de ce court-métrage il réalisera plusieurs autres œuvres de commandes, toujours en rapport avec les luttes comme Un homme est mort au sujet de la mort d’Edouard Maze tué par un gendarme en manifestation[1], L’Algérie en flammes pour le FLN algérien en pleine guerre d’Algérie et qui lui valut quelques déboires malgré la diffusion régulière à la télévision algérienne de son film[2]. Il réalisa aussi des films comme Un peuple en marche sur l’Algérie indépendante, Avoir vingt ans dans les Aurès sur la guerre d’Algérie et pour lequel il reçut en 1972 un prix à Cannes, La folle de Toujane qui fait le parallèle entre la situation coloniale et celle de la Bretagne, Frontline sur le régime d’Apartheid en Afrique du Sud ou Mission pacifique sur la reprise des essais nucléaire en Polynésie française par Chirac. Entre autres, il fut aussi le créateur du centre audiovisuel d’Alger à la sortie de la guerre et fut une grande inspiration pour les premiers cinéastes d’Afrique. Praticien en quelque sorte de ce qu’on appelait le film d’intervention sociale[3], qui doit refléter la réalité et servir à la transformer[4], René Vautier était aussi militant CGT[5] et du PCF – parti qu’il n’a jamais quitté depuis son entrée à l’IDHEC et même durant sa période algérienne. La plupart de ses films ont été interdits et distribués sous le manteau et sans possibilité de diffusion à la télé. C’est le cas d’Afrique 50.
Le film s’ouvre sur l’annonce que le film est une commande pour la Ligue de l’enseignement, tourné entre 1949 et 1950. Notre première entrée en Afrique est celle d’un petit village du Niger. Les maisons sont petites et miséreuses. Nous voyons des enfants cachés derrière des murs à la vue du cinéaste parce que, dit-il, c’est le premier blanc à entrer dans le village qui n’est ni l’administrateur colonial pour récupérer l’impôt ni le recruteur de l’armée. La curiosité prenant le pas sur d’autres considérations, les enfants nous sont montrés en gros plan, tout d’abord un à un, puis en bande et ceux-ci acceptent de faire visiter le village. Les menues activités du village (mariage, coiffure, travail des femmes, jeux des enfants, scène de prière) nous sont montrées, accompagnés d’un commentaire du narrateur, comme lorsque les enfants jouent et que la voix rappelle que seuls 4% des enfants d’Afrique occidentale sont scolarisés. Aux français qui s’étonnent en voyant ces images de voir un village sans médecin et sans école, le narrateur dit – et c’est à ce moment que le documentaire prend toute sa forme contestataire : « En Afrique, on ouvre une école quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de comptables. On envoie un médecin quand les grosses compagnies coloniales ont besoin de main d’œuvre. »
Le film, qui nous dit que le village vu précédemment a de la chance car il est en paix, nous présente un autre village de la Côte d’Ivoire qui n’a pas pu payer l’impôt colonial. Le 27 février 1949, les troupes ont détruit le village et tué hommes, femmes et enfants, puis abattu le troupeau. Le narrateur, qui hurle presque, répète qu’il s’agit de « balles françaises » qui ont transpercé ces malheureuses victimes et que ce crime abominable a été commis « en notre nom à nous, gens de France ».
Le narrateur rappelle que l’image de la colonisation pour la France c’est une belle réussite d’élévation des peuples, mais la réalité c’est qu’il s’agit du règne des vautours (que l’on voit à l’image). Les vautours qui se partagent l’Afrique ont un nom : Société commerciale de l’ouest africain (660 millions de bénéfices en 1949), Compagnie française de l’Afrique occidentale (365 millions de bénéfices en 1949), Davon (180 millions de bénéfices en 1949) et tant d’autres, dont l’anglaise Unilver. C’est 40 millions par jours volés aux Africains ! Le narrateur objecte qu’on lui dira que le colonisateur a apporté le progrès en Afrique. Il montre donc un barrage effectivement créé pour amener l’électricité. Seulement celui-ci est fait pour alimenter les maisons des blancs et fonctionne au travail manuel, celui des noirs qui doivent trimer la journée pour le faire marcher. Afin de bien nous en rendre compte, Vautier filme les africains travaillant en gros plan, réalisant des gestes répétitifs et abrutissants. Le travail fait par des machines en Europe est fait par des noirs en Afrique car le coût de la main d’œuvre est moins cher que l’entretien d’une machine. Peu importe donc que la tâche les use, adultes comme enfants, à travailler 16h par jour sur divers travaux manuels comme l’entretien des routes. Quand le film compare le bousier (image à l’appui), qui peine à rouler sa bosse, aux africains, il remarque que le bousier trime pour construire sa maison alors que les africains travaillent au profit d’un autre. L’autre étant les grosses compagnies coloniales. Le travail obligatoire a été aboli en Afrique, mais les villages doivent payer l’impôt et comme le village cité précédemment ils risquent la mort si l’impôt n’est pas honoré, alors ils sont obligés de s’employer pour les grosses compagnies coloniales.
Arrêtons-nous un instant sur ce point. Il est devenu désormais courant d’entendre en France parler de la question coloniale de manière contemporaine en pointant exclusivement la question du racisme et de la supériorité blanche. Ce n’est pas le discours de René Vautier, militant communiste. En effet, ce qui est trop passé sous silence de nos jours par nos intellectuels « post-coloniaux » c’est l’aspect économique. En effet, si le racisme et la théorisation du « devoir de civilisation de l’homme blanc » sont très importants, notamment dans la colonisation française, le point cardinal de la colonisation, c’est l’exploitation de la force de travail. Rappelons que Marx a démontré dans le Capital que le capitaliste voit son profit créé par la plus-value[6] générée par la force de travail de ses ouvriers – le travail étant l’unique source de valeur des biens et services échangés (quoi qu’en disent aujourd’hui nos « économistes » libéraux qui prennent les rapports de propriété pour une donnée naturelle). A son apogée au 18ème siècle, la bourgeoisie d’Europe a déployé toutes les stratégies pour maintenir les salaires les plus bas possibles, c’est-à-dire permettant tout juste aux ouvriers d’être présents le lendemain et de faire des enfants (renouvellement de la force de travail). Certes les machines ont pu faire augmenter considérablement la productivité et donc les profits, mais si un même travail peut être fait par un travailleur pour moins cher et pour une rentabilité supérieure, le capitaliste va la préférer. En Europe, même si l’exploitation était tout de même féroce, à force de luttes l’exploitation a pu s’atténuer et les profits diminuer. Les capitalistes ont alors cherché d’autres marchés où pouvoir exploiter la main d’œuvre pour pas cher. Là est le principe de la colonisation des peuples transformés en main d’œuvre docile qu’on peut mater sans vergogne s’ils ne se conforment pas à l’exploitation par les sociétés capitalistes d’Europe. Cette même exploitation de la force de travail qui est partagée dans tous les pays du monde, en France comme en Afrique, permet à René Vautier de faire le lien avec les luttes des travailleurs en France pour leur dignité.
Au bout de la 12ème minute, le narrateur cite une succession de villes africaines où le peuple s’éveille pour réfléchir. Les peuples d’Afrique se dressent et cherchent à comprendre l’origine de leur exploitation. Le mouvement populaire naissant – rappelons que nous sommes à l’époque de la création du Rassemblement Démocratique Africain, parti regroupant plusieurs colonies françaises – demande à ce que la Constitution française soit appliquée dans sa partie sur l’indépendance progressive des colonies. Toutefois, comme le dit le réalisateur, ces manifestations pacifiques se heurtent à une administration coloniale corrompue, que même un député du MRP (parti de droite) critique comme honteuse[7]. La répression est terrible et Vautier nous cite plusieurs villes ravagées par l’armée française, sonnant aux africains comme des « Oradour », ville française massacrée par les nazis. Il cite plusieurs noms de militants assassinés, comparés aux résistants français contre l’Allemagne nazie à l’instar de Guy Môquet. Il s’agit de lier dans ces deux phrases la résistance contre un ordre injuste et despotique qu’il y eut en France et celui que subissent les africains par la France. Les images de villages, au gré d’une musique plus lente défilent, afin de nous montrer la gravité de la situation, tandis que la voix éructe presque en dénonçant les faits.
Nous voyons ensuite une image de la prison de Batam où croupissent plusieurs africains résistants et où est morte Mamba Bakayoko, qui se battait pour que les écoles soient créées dans chaque village d’Afrique et qu’on amène des machines pour servir l’Afrique et non l’asservir. Ce dernier point peut nous faire penser aux rôles censés être joués par la machine selon les marxistes, celui de libérer du temps aux hommes qui ne sont pas seulement des bêtes à exploiter. Encore une fois Vautier lie la lutte des peuples d’Afrique à celui du peuple français en disant qu’ils luttent côte à côte pour la paix et la liberté, ce qui se caractérise par la reprise d’une scène dans son film d’images tournées lors de la grève des mineurs en France en 1947. Les africains vont « gagner la bataille de la vie ». Ce dernier était un slogan de la CGT.
Afrique 50 est une commande de la Ligue de l’enseignement à René Vautier, qui a seulement 21 ans à l’époque. Le film a donc pour but d’être diffusé dans les collèges et lycées à un public assez jeune. Le film devait montrer l’œuvre civilisatrice de la France dans les colonies, avec cependant toute liberté pour le faire. Il y part avec un groupe de géographes et d’historiens, dont son ami cinéaste Raymond Vogel[8], lui aussi communiste. Bien qu’ayant cette appartenance politique, Vautier n’avait aucun a priori sur la colonisation lorsqu’il décide de faire ce film[9]. C’est en découvrant Bamako et la misère environnante que sa vision et celle de son ami Vogel change. Commençant à filmer et se bagarrant avec l’équipe de tournage, il attire l’attention de l’administration coloniale qui trouve qu’il ne filme pas ce qu’il devrait filmer. En effet, un décret demande à ce que tout film fait sur la colonisation fasse l’objet d’un scénario préétabli et validé par l’administration coloniale. Un décret de 1934… signé Pierre Laval ! Cette même personne que Vautier avait combattu durant la Résistance et qui avait été fusillé à la sortie de la guerre. C’est à ce moment que le destin du film changea : le réalisateur ayant une altercation avec le policier, il s’enfuit accompagné de Raymond Vogel, pellicule en main. Ils se cacheront chez différentes personnes et parcourrons clandestinement le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Vogel sera arrêté en Côte d’Ivoire et réussira à s’échapper avant de retourner en France. Vautier finira son voyage seul. Afin de faire son film, il a suivi une colonne punitive de militaires français, ce qui va donner lieu entre autres à la scène du village abattu.
Les bobines du film ont été ramenées par 34 voies différentes par des étudiants africains venant étudier en France, les cachant même derrière un film pornographique. Finalement remis à la Ligue de l’enseignement, c’est ce même organisme qui va donner à la police les pellicules. Etant obligé de venir au commissariat signer, après visionnage, le fait qu’il ait tourné le film, Vautier en profitera pour dérober plusieurs bobines (17 sur 50). Concrètement le film va être fait à partir de celles-ci et elles correspondent à environ 30% des images tournées. Raymond Vogel ne participera pas au montage car il était occupé à ce moment-là par son film Terre tunisienne. René Vautier va faire son film dans l’école d’Argenteuil où travaillait sa mère : il va découper et coller les images d’Afrique 50 dans la salle de bain de sa mère, puis enregistrera le son en plein air, en lisant lui-même le texte, avec à la musique l’orchestre de Keita Fodeba. En quelque sorte, la maison du peuple de la CGT d’Argenteuil a aussi participé au film en protégeant la maison et en accompagnant le projet.
Pour qui est fait le film ? Le film de par sa commande était destiné à un public mineur dans un but éducatif d’apprentissage de l’histoire. Cependant, son résultat final étant tout autre, nous ne pouvons pas dire qu’il s’adresse à ce public en particulier. Il est davantage destiné à faire connaître la situation africaine en France (d’où les interpellations nombreuses au peuple français, a contrario de son futur L’Algérie en flamme qui ne s’adresse pas au même public), afin de donner l’envie de soutenir la libération des peuples d’Afrique. Il lie d’ailleurs constamment le combat de la résistance à l’oppression coloniale africaine à la résistance française. Une chose que l’on voit encore dans une interview disponible sur internet où il raconte le moment où un policier ancien FFI a sympathisé avec un résistant algérien qu’il emmenait au tribunal[10].
Le film va ensuite être condamné et interdit de diffusion, René Vautier étant même condamné à un an de prison ferme en 1955. Le film sera diffusé de manière illégale, sans visa, parmi divers réseaux militants comme l’UJRF et les scouts de France, qui continueront même à le diffuser pendant l’emprisonnement de Vautier, emprisonnement qui relancera d’ailleurs sa diffusion ! Le court-métrage reçoit un prix au festival mondial de la jeunesse de Varsovie et est aussi cité dans les trois meilleurs documentaires de l’année 1950. Le documentaire connaîtra aussi de nombreux éloges dans la presse militante, dont celle de Jacques Krier dans L’écran français. Bien plus tard, en 1989, René Vautier a appris que son film était diffusé dans toutes les ambassades de France en Afrique afin de prouver que déjà à l’époque des français se battaient contra la barbarie coloniale. En 1996, le ministère des affaire étrangères lui rend l’exploitation de son film et permet sa diffusion, même si Afrique 50 n’a jamais encore été diffusé à la télévision. Selon les calculs du ministère donné à Vautier, c’est environ 1 millions de spectateurs qui ont pu voir le film.
Le but de René Vautier dans ses films et notamment celui-là, c’était de donner la parole à ceux qui se battent pour que les choses changent. S’il n’a pas inventé le terme, ses films s’inscrivent dans le cadre des films d’intervention sociale qui voit les images comme un prisme permettant de refléter la réalité et d’influencer le développement de celle-ci. René Vautier peignait la réalité telle qu’il la voyait, ce qui rend beaucoup de ses films, même de fiction (comme Les trois cousins, Avoir vingt ans dans les Aurès et Les remords), très bruts de décoffrage. Il a toujours fait un cinéma de lutte s’inscrivant dans ses origines prolétariennes, avec la volonté de montrer tout ce qui rapprochait les peuples.
Ambroise-JRCF
[1] Le film a été détruit, mais il reste une bande-dessinée à ce sujet et un film d’animation suivant la BD.
[2] Vidéo « René Vautier, cinéaste et militant anti-impérialiste » par Michel Le Thomas, Les films de l’an 2, 04/02/2020.
[3] Vidéo « Un homme est mort. René Vautier le film d’intervention sociale », chaîne de Loïc Chapron, 14 octobre 2014.
[4] Nous pensons à la célèbre phrase de Marx indiquant que les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, alors qu’il est important de le changer.
[5] L’écran rouge, un livre sur le cinéma et la CGT, page 140.
[6] Différence entre la valeur créée par la force de travail dépensée chaque jour – transférée aux biens produits qui sont la propriété du capitaliste -, et la valeur de cette force de travail sur le marché, correspondant à la valeur des biens de consommation nécessaires à la reproduction journalière de cette force de travail. Ex : 10h de travail social moyen versus 4h.
[7] Elément cité dans le film.
[8] Les communistes et le cinéma de Pauline Gallinari.
[9] « Entretien avec René Vautier réalisateur du film : Afrique 50 », 24/09/2015.
[10] « Lorsqu’un résistant français s’identifie à un résistant algérien (témoignage de René Vautier) », 20/02/2015.
René Vautier, un orfèvre en Afrique Occidentale Française
/ PYD

Jusqu’à la fin de l’Afrique Occidentale Française, en 1958, l’administration coloniale française contrôlait scrupuleusement les images captées sur son sol. Aujourd’hui, nous ne disposons donc d’aucun film qui présenterait des images authentiques de l’époque coloniale, si ce n’est le petit bijou de René Vautier – qui nous a quittés le 04 janvier 2015 –, Afrique 50 (cliquez ici pour voir le film) tourné en 1949, mais censuré jusqu’en…1996. Quant à sa première diffusion sur une chaîne française, elle n’eut lieu qu’en 2008. Pourquoi une telle inertie ? Est-ce parce que la colonisation serait une phase historique dépassée et bien connue du public ? Que de toute façon, tout le monde sait bien qu’il faut être « anticolonial » ? N’est-ce pas plutôt que le film, aujourd’hui encore, nous invite à réfléchir à ce qu’est une « colonisation », et à nous demander si quelque chose a réellement changé depuis la « décolonisation » ?
Un tournage mouvementé
En 1949, la Ligue de l’Enseignement commande à René Vautier son premier film, un documentaire sur « la vie réelle des paysans d’Afrique de l’Ouest », qu’elle a l’intention de diffuser dans tous les lycées de France. L’idée de la Ligue était peut-être d’aller au-delà des films plus idéologiques qu’informatifs diffusés alors au journal de 13 heures, et encore longtemps après le film de Vautier. Il est parti, dit-il, sans idées préconçues sur la colonisation. Son but était d’honorer son contrat, et de filmer cette vie réelle dont il ne savait rien. Sur place, il découvre une réalité sordide : l’exploitation des Africains par les compagnies coloniales, la répression sanglante par l’administration française. Ce n’est que lorsque la police française prétendra lui dicter ce qu’il doit et ne doit pas filmer qu’il va prêter sa caméra à ceux qu’on ne veut pas montrer. On ne gagne donc rien à qualifier le film « d’anticolonial » : Vautier n’habille pas d’images africaines une idée qu’il aurait fabriquée en Europe. Il se comprend comme un témoin plus que comme un militant. Il veut « refléter ce qui se cache sous la réalité qu’il filme ».[1] Il veut en particulier refléter les raisons qui poussent les Africains à s’orienter vers l’indépendance.[2] Comme Vautier le dit lui-même : « J’ai découvert que j’avais fait quelque chose d’utile à partir du moment où on a commencé à vouloir me l’interdire. »[3]
Quand il signe son premier contrat avec la Ligue de l’Enseignement, il n’a que 21 ans et sort à peine – major de promotion – de l’IDHEC (Institut Des Hautes Etudes Cinématographiques, actuelle Fémis). Mais il a déjà un caractère bien trempé. Quand les Allemands arrivent à Quimper, en juin 1940, Jean Vautier et son petit frère René, en classe de 5ième au lycée de Quimper, sont scouts chez les Eclaireurs de France. Les Allemands interdisent le mouvement, qui rentre dans la résistance et la clandestinité. Pour René Vautier, la résistance a donc commencé à 12 ans. Son sens de la déclamation poétique – sensible dans Afrique 50 – lui vaut pour premières missions de réciter et diffuser des poèmes de résistance. Puis, au sein du groupe des jeunes du clan René Madec, il fait des relevés d’angle de tir des blockhaus allemands, en navigant avec son frère Jean sur l’Odet. Puis il recherche des dépôts de munitions, lance des grenades, et semble avoir pris la guerre en dégoût. A la Libération, René Vautier est le benjamin du groupe qui a pris le nom de Roger Le Bras, et dont les 16 membres reçurent la croix de guerre avec palmes et – fait unique pour un groupe de jeunes – furent cités à l’Ordre de la Nation pour faits de résistance par le Général de Gaulle. Cela fait de René Vautier le plus jeune décoré de la seconde guerre mondiale.[4] Ce n’est pourtant pas lui que les autorités françaises venaient chercher pour les célébrations du 08 mai.
C’est à la demande de ses amis, dit-il, qu’il part à l’IDHEC : il poursuivra le combat avec une caméra 16mm. Dans le cadre de ses études, il participe comme stagiaire au film d’André Dumaître qui couvrait la grève des mineurs et sa répression en 1948 – participation de courte durée, car, alors qu’il est supposé filmer du côté policier, il passe du côté des grévistes, ce qui lui vaut sa première arrestation de cinéaste. C’est à cette occasion que le secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur, chargé de l’information, François Mitterrand, fait passer le décret dit « Jules Moch », le 06 décembre 1948, qui crée un visa non commercial et soumet à autorisation la diffusion d’un film, même dans les réseaux non commerciaux. Ce décret vise directement les syndicats et les empêche de diffuser les films militants. C’est en parti contre lui, et plus généralement contre l’arbitraire de la censure politique en matière cinématographique, que Vautier entamera une grève de la faim en 1973, et obtiendra gain de cause. C’est là l’origine de la classification X, qui eut pour conséquence indirecte la fin de la diffusion du cinéma politique dans les petites salles : pour tenir face à la concurrence des grandes salles, celles-ci ont généralement choisi de s’estampiller X, et de s’assurer ainsi le marché émergent de la pornographie. Mais personne n’irait voir un film politique dans une salle réputée pour son cinéma pornographique.
Son expérience de la clandestinité va lui être particulièrement utile pour le tournage d’Afrique 50. Vautier se rend ingénument à Bamako, et commence à tourner. Les difficultés commencent au bout de 10 jours : des policiers l’avertissent qu’il ne filme pas ce qu’il faut filmer, et lui opposent un décret du 08 mars 1934 signé de Pierre Laval, alors Ministre des Colonies. Selon ce décret, toute prise de vue dans une colonie d’Afrique Occidentale Française doit être soumise à l’autorisation du lieutenant gouverneur de la colonie concernée. Toute l’ambivalence de l’administration française d’après guerre apparaît dans cette affaire : la même administration qui a fait exécuter Pierre Laval en 1945 en applique scrupuleusement les décrets cinq ans plus tard pour censurer les images tournées dans les colonies. Vautier refuse de se plier à un décret signé Laval et s’enfuit de Bamako. C’est sur le chemin du retour qu’il filme clandestinement 51 bobines de 3 minutes chacune, reflétant l’émergence des mouvements indépendantistes et leur violente répression.
Vautier ne rapatrie pas lui-même les bobines, dont il sait qu’elles seront saisies. Une trentaine d’étudiants africains s’engagent donc à ramener les bobines qu’ils se chargent de rapporter aux bureaux de la Ligue de l’Enseignement. C’est là, a posteriori, d’une surprenante naïveté : si toutes les bobines parviennent aux bureaux de la Ligue, son directeur les confie immédiatement à la police qui veut les saisir à la demande du ministère de l’Outre-Mer, dont le ministre est alors François Mitterrand. Vautier est alors inculpé pour tournage sans autorisation, en vertu du décret de 1934.
Pour constituer le dossier d’inculpation, la police, qui a elle-même développé les bobines, organise une séance de projection en présence de Vautier : il devait signer chaque boite pour certifier avoir tourné les bobines visionnées. Mais il profite de l’obscurité de la salle pour en soustraire 17 au zèle de la police, celles qui font la base du film qu’on peut voir sous le nom d’Afrique 50. Le montage en fut fait dans l’école primaire de Quimper où sa mère était institutrice. Le son fut créé en France, car en Afrique, Vautier ne disposait d’aucun moyen pour enregistrer le son. La musique est assurée par un groupe africain, l’ensemble de Keita Fodéba, mais c’est Vautier qui assure le commentaire sonore.
Le résultat de près de 18 minutes, projeté une première fois à Quimper, est immédiatement interdit. Vautier est condamné à un an de prison, peine qu’il n’effectuera pas, mais il sera enfermé plusieurs mois à la prison militaire de Saint-Maixent-l’école, puis en zone occupée à Niederlahnstein. Le film va néanmoins largement circuler, en particulier grâce aux mouvements de jeunesse issus de la Résistance, de toutes tendances, des Eclaireurs de France à L’UJRF (Union des Jeunes Républicains de France, c’est-à-dire les communistes) en passant par le réseau des Auberges de Jeunesse. Le film obtiendra même le prix du meilleur documentaire mondial des jeunes réalisateurs à Varsovie.
Rassemblement du RDA en Côte d’Ivoire
La décolonisation ne mit pas fin à la censure. Le film n’a été remis à son propriétaire et autorisé à recevoir un visa d’exploitation (que Vautier n’a pas demandé) qu’en 1996 (un an après la mort de François Mitterrand). Il fut alors montré à Cannes sous l’égide de l’association France-Liberté dirigée par Danielle Mitterrand. Comme le souligne la lettre du Ministre des Affaires étrangères, le film s’avère désormais très utile pour démontrer aux Africains qu’il existait aussi en France des sentiments anticoloniaux dès 1950. Le film est alors montré par le ministère des Affaires étrangères dans les Ambassades de plus de 50 pays du monde…, mais pas en France : il n’est diffusé en France, sur la chaîne payante Cinecinéma Classic, que le 20 février en 2008, à 23h20 (mais au terme d’une soirée consacrée à Vautier), il y a à peine 8 ans de cela.
Colonisation et compagnies coloniales
Que sont allés faire les Français en Afrique de l’Ouest ? On parle de « colonie ». Mais le mot lui-même n’est pas clair du tout. Carthage aussi est une « colonie » de Tyr : cette implantation n’a pourtant aucun rapport avec l’Empire colonial français. Carthage devient une cité florissante. Que deviennent les pays de l’AOF ? Les archives de Vautier nous permettent de comprendre très concrètement les différentes relations de dépendance qui existent entre la colonie et la métropole.
Sur le Niger
Le film de Vautier s’ouvre sur un village de pêcheurs en bordure du fleuve Niger, peut-être un village malien, dont le pittoresque « cache mal une grande misère » : si les enfants jouent par terre avec une coquille d’escargot en guise de toupie, c’est parce qu’il n’y a d’école que pour 4% des enfants en âge d’être scolarisés : que faire d’autre alors ? Mais Vautier passe rapidement de ces belles scènes de pêche, de tissage et de baignade à la réalité coloniale : il poursuit par les murs ensanglantés du village de Palaka[5], au nord de la Côte d’Ivoire, où la colonne Folie-Desjardins, le 27 février 1949, a mené une expédition punitive pour un reliquat d’impôt non payé (3700 francs, c’est-à-dire, sauf erreur, 6 euros). Ces expéditions s’étendaient dans toute la région.
La force devant laquelle les Africains se courbent, c’est la nécessité de payer l’impôt dans une monnaie qu’ils n’ont pas, le franc. Seules les compagnies coloniales sont susceptibles d’approvisionner les villages en monnaie sous forme de salaire. Aussi, il est vrai que l’esclavage est juridiquement aboli dans les colonies françaises en 1848 – Victor Schœlcher est clair sur les justifications de cette loi, moins une mesure humaniste qu’un moyen de créer les conditions d’une colonisation durable en Afrique. Cela signifie simplement qu’une compagnie privée n’a pas le droit d’avoir des esclaves, mais n’empêche nullement l’administration française de contraindre la population, selon des griefs divers, de travailler aux grands projets d’aménagement. Le « travail forcé » n’est lui-même aboli qu’en 1946 (loi Houphouët-Boigny). Mais n’est-il pas ridicule d’appeler « travailleur libre » celui qui n’a matériellement d’autre choix que de travailler pour 50 francs (10 centimes d’euros) par jour ?
Barrage de Markala-Sansanding
L’un des arguments centraux de Vautier est que les compagnies coloniales préfèrent employer des Africains plutôt qu’introduire des machines : cela leur revient moins cher. Les images les plus spectaculaires sont celles qu’il tourne dans le Soudan français, au célèbre barrage hydroélectrique de Markala-Sansanding, dont les vannes, à l’approche des navires commerciaux, sont actionnées non par l’énergie électrique, mais par des ouvriers soudanais. Ce barrage était fréquemment présenté comme l’un des fleurons de la mise en valeur de l’AOF[6]. On reconnaît en général que sa construction, qui s’est étalée de 1934 à 1947, s’est faite grâce aux travaux forcés.[7] Mais les images de Vautier montrent que ce travail forcé s’est étendu à son utilisation.
Cependant, quel rôle jouent les machines dans une société coloniale ? Et dans nos sociétés ? Si nous passons outre la fascination qu’exerce sur nous la technologie de pointe, que reste-t-il ? Quand on réduit le travail d’un homme à des opérations mécaniques, une machine finit nécessairement par le remplacer. Quand les caisses deviennent automatiques, la caissière est libre d’aller grossir les rangs des chômeurs. Les remarques de Vautier ne sont donc pas suffisantes. Il démontre l’hypocrisie qu’il y a à mettre en avant l’introduction du progrès industriel en Afrique, alors qu’en même temps un petit enfant de 5 ans actionne seize heures par jours les soufflets qui entretiennent le feu du forgeron. Mais qu’une machine le remplace, son père n’en aura pas moins besoin de monnaie.
Vautier indique les bénéfices annuels des grandes compagnies qu’il énumère : la Société Commerciale de l’Ouest Africain, la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale, Davum, l’Africaine Française, Unilever, Lesieur, etc. Que sont devenues ces sociétés ? Ont-elles disparu en même temps que la colonisation ?
Lesieur appartient aujourd’hui au groupe Saipol, lui-même contrôlé par le groupe agro-industriel Avril. En 2012, son chiffre d’affaire est de 732 millions d’euros. Unilever est aujourd’hui le 4ième groupe mondial dans l’industrie agro-alimentaire, et son chiffre d’affaire en 2014 est de 48 millions d’euros. La Compagnie Française de l’Afrique Occidentale (CFAO), qui s’était spécialisée dans la distribution automobile et la production industrielle en Afrique, a été rachetée par François Pinaut en 1990 (groupe Pinaut-Printemps-La Redoute, aujourd’hui groupe Kering), puis par Toyota Tsusho en 2012. Pour l’année 2014, son chiffre d’affaire est de 3,6 milliards d’euro. Est-il vraiment exagéré de dire que les grandes sociétés d’aujourd’hui se sont imposées grâce la sueur du travail forcé ?
Vautier termine son film par quelques images d’une manifestation française, peut-être tournées quelques mois plus tôt pendant la grande grève des mineurs. Sa conclusion n’est pas que les populations africaines luttent contre les Français, mais que le peuple africain « tiendra sa place dans la lutte commune, jusqu’à ce que soit gagnée la bataille de la vie ». N’est-ce pas suggérer que le colonialisme n’est que l’une des manifestations d’un problème plus souterrain, commun aux populations des métropoles et à celles des colonies, qu’une simple « décolonisation » déplacerait sans le résoudre ?
La répression
Il n’est pas toujours évident de comprendre ce que filme Vautier, en raison des bobines manquantes. Pour faciliter le visionnage du film, je précise ici simplement les lieux et événements auxquels il fait référence dans son commentaire.
Ce que montre Vautier, c’est la manière dont le pouvoir économique est soutenu par le pouvoir répressif de l’administration française. Depuis la création en 1946 du Rassemblement Démocratique Africain, les mouvements indépendantistes émergent et sont violemment réprimés. Outre la tuerie de Palaka, Vautier filme également la prison de Grand-Bassam, à 40 km d’Abidjan, où sont enfermés les militants anticolonialistes du RDA. Il insiste sur la mort de Mamba Bakayoko, peut-être emprisonnée et assassinée à la suite de la « marche des femmes » du 24 décembre 1949, femmes qui se rendaient à la prison pour réclamer la libération de leurs époux.[8]
Les images de désolation que filme Vautier, ainsi que celles de l’émergence des mouvements indépendantistes, ont dû être tournées en Côte d’Ivoire et au Mali. C’est la voix off qui indique ce qui, peut-être, est en train d’être filmé. Le gouvernement SFIO de l’époque entame un rapport de force avec le RDA d’Houphouët-Boigny, et ordonne l’arrestation de membres de la section ivoirienne du RDA. En réponse, le Parti Démocratique de Côte d’Ivoire organise une grève des achats des produits importés. L’administration coloniale envoie l’armée à Bouaflé le 21 janvier 1950 (3 morts, de nombreuses arrestations, ainsi que la disparition, quelques jours plus tard, du sénateur RDA Victor Biaka Boda), à Dimbokro le 30 janvier (14 morts, 50 blessés, après que le commandant ait fait tirer sur la foule qui craint l’arrestation d’Houphouët-Boigny), à Séguéla le 2 février (3 morts).
Village ivoirien
Ce ne sont là que les actes de répression que Vautier cite parce qu’il en fut le témoin direct. Il les place dans une perspective plus globale en rappelant des événements un peu oubliés aujourd’hui : les assassinats de Thiaroye, au Sénégal, le 1er décembre 1944 (70 morts), le massacre du Sétif du 08 mai 1945 (pendant les festivité qui marquent la fin de la guerre), la répression contre l’insurrection malgache entre 1947 et 1948 (89 000 morts d’après la première mission parlementaire de 1949, sur la base des données de l’armée elle-même, mais le chiffre est toujours révisé, à la hausse comme à la baisse), le bombardement du port de Haïphong (6000 morts), qui marque le début de la guerre d’Indochine, le 23 novembre 1946.
Un jeune militaire téléphonait à son officier de caserne. Il lui annonçait avec fierté qu’il avait mis en pièce un père de famille et ses enfants au cours d’une soirée dansante. Il détaillait tous les coups de pieds et tous les coups de poings. Il en tremblait d’émotion. Son supérieur semblait très satisfait de lui. J’étais dans le train pour Bordeaux, et le jeune soldat partait rétablir l’ordre à Mayotte. Nous étions en 2011. Quid novi sub sole ?
Le cinéma de Vautier prend toujours place dans un conflit. Il n’essaye pas de le surplomber, mais de faire contre poids aux images officielles qui reflètent moins la réalité que la complaisance de leurs auteurs à l’égard du pouvoir, si pervers soit-il. Le réel que nient ces images, Vautier va le filmer. La force y perd de son éclat, et la vie y gagne en dignité. Le combat auquel Vautier prend part en 1949 n’a pas dû lui paraître très différent de son combat de résistant : il combat les mêmes décrets, les mêmes comportements, en somme la même administration. Après tout, il n’a pas été fait magiquement table rase de l’ancienne administration en 1945.
Afrique 5O a été réédité avec un livret d’information par la coopérative les Mutins de Pangée. René Vautier aurait participé à environ 180 films. Parmi ceux qu’il a lui-même dirigés, seul un très petit nombre est plus ou moins facilement accessible. Les films consacrés à l’Algérie, les plus connus avec Afrique 50, peuvent parfois être trouvés en bibliothèque municipale. Beaucoup n’ont jamais obtenu de visa commercial, certains ont simplement été détruits. Un fonds Vautier a été créé à la Cinémathèque de Bretagne, pour récupérer les copies disséminées de par le monde. Citons également le film de la jeune cinéaste Oriane Brun-Moschetti, Salut et fraternité, les images selon René Vautier (2015) : elle œuvre activement à transmettre la conception exigeante qu’avait Vautier du cinéma. Je ne résiste pas non plus à l’idée de mentionner le petit montage d’un certain Mattlouf, Sarkolonisation, qui mêle habilement le discours de Dakar prononcé par Nicolas Sarkozy, alors Président de la République, le 26 juillet 2007, avec en contre-point des extraits adéquats d’Afrique 50.
PYD
[1] http://oeil.electrique.free.fr/article.php?articleid=104&numero=13
[2] Interview de Moïra Chappedelaine-Vautier, en bonus du DVD édité en 2009 par la Cinémathèque de Bretagne.
[3] http://oeil.electrique.free.fr/article.php?articleid=104&numero=13
[4] http://www.eedf.fr/ressources/downloads/vautier_palluau.pdf
[5] « Palaka » d’abord une langue, et par extension la région où cette langue est dominante. Je ne sais pas si le mot désigne également un village spécifique, où si Vautier parle plus généralement de la région du Nord de la Côte d’Ivoire.
[6] http://www.ina.fr/video/AFE85001141/realisations-coloniales-en-afrique-occidentale-francaise-video.html
[7] Cette construction a été finalisée par un consortium regroupant la Société Nationale des Travaux Publics, les Etablissements Meunier-Gogez et la Société de Construction des Batignolles.
[8] Je n’ai pas trouvé d’information sur elle.