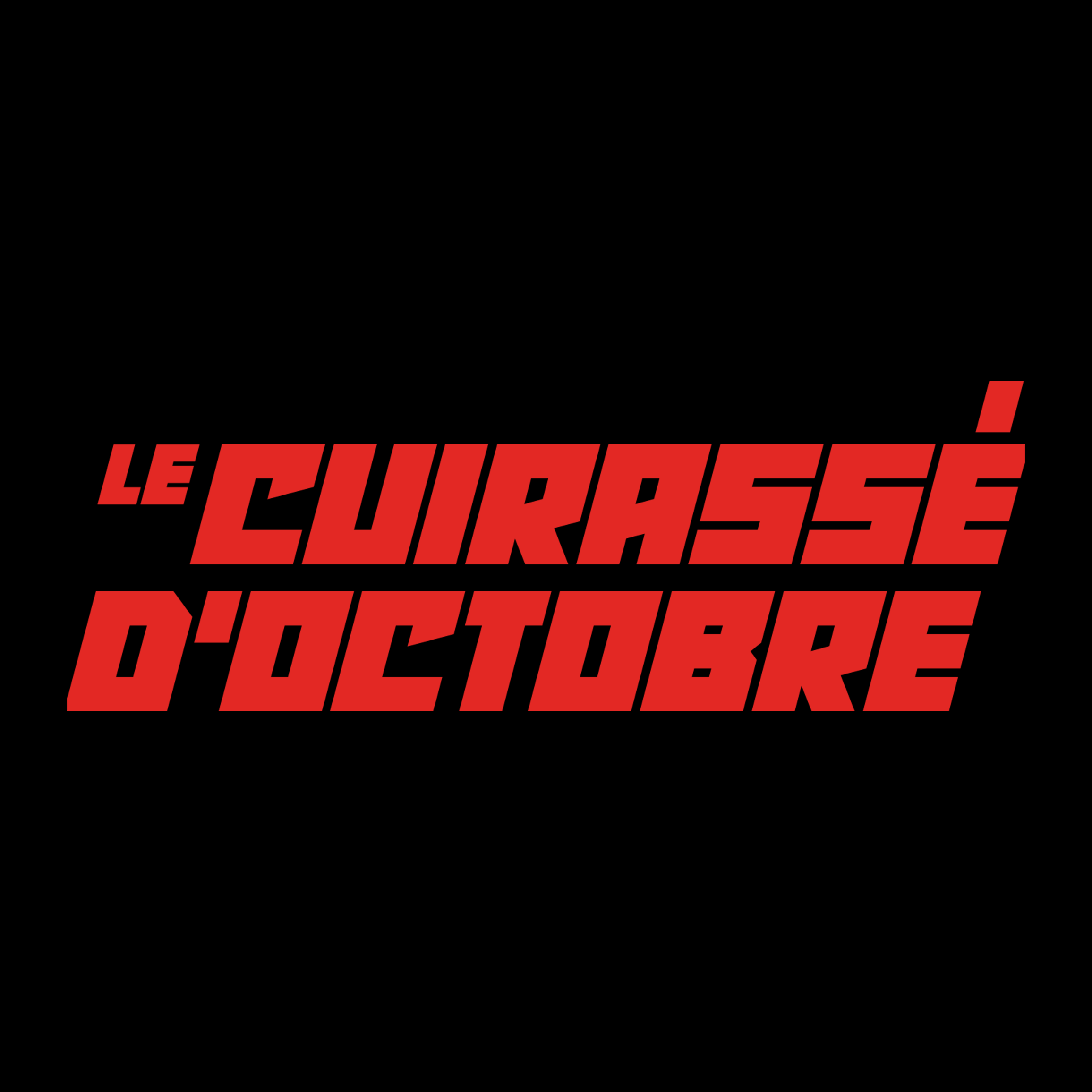Le film va tracer le parcours de la vie de Baxter avec les humains, de sa première adoption à sa mort, où il apprend à connaitre peu à peu le monde et à affirmer ce qu’il recherche chez un humain. La structure narrative du film est découpée en 3 actes, correspondant pour chacun à trois maitres de Baxter.

Le premier acte est sur la vieille dame, première propriétaire du bull-terrier. Celle-ci a tout d’abord peur de Baxter, ce qui le rendra mal-à-l’aise. Il fera un effort pour se rendre plus appréciable auprès de la vieille dame mais cela n’améliorera pas sa situation, celle-ci s’enfonçant dans la sénilité et s’enfermant chez elle, coupant Baxter de son lieu privilégié le jardin. Le chien enrage aussi car elle ne lui donne aucune utilité concrète. C’est cette impossibilité du dialogue qui va amener à un destin tragique. Lorsqu’elle tentera de plonger Baxter dans son bain, cela fera ressurgir son passé traumatisant et le poussera à tuer sa propriétaire en la faisant tomber dans l’escalier.
Ses seconds propriétaires sont un couple voisin vu un peu plus tôt dans le film. Cette partie s’appelle « Les jours heureux ». Ce couple joue avec lui, lui donne un rôle à jouer. Ces moments où il se sent bien vont changer avec l’arrivée de l’enfant du couple qui accapare son attention au détriment de Baxter. Ce dernier n’ayant pas de structure familiale, il n’arrive pas à comprendre ce changement, ni pourquoi ils sont intéressés par un être aussi faible. Les liens seront définitivement rompus quand Baxter tentera de tuer l’enfant, celui-ci ayant été déçu par le couple et ces derniers ne lui faisant plus confiance.
Le troisième et dernier maitre de Baxter, l’humain qui lui ressemble, est un enfant qui s’appelle Charles. C’est celui avec lequel sa relation est la plus complexe et le seul autre personnage ayant droit à son propre développement avant Baxter, préparant à sa rencontre avec le bull-terrier. Une rencontre fatidique qui sera d’abord merveilleuse pour le canidé, l’enfant lui donnant des ordres et un rôle bien précis. Si Baxter trouve des similitudes entre eux, il existe un point de divergence, c’est que Charles est un sociopathe. Là où Baxter ne sort pas de son animalité malgré ses capacités cognitives, Charles régresse par rapport à la culture[1] et se montre dépourvu de sentiment, de plus attiré par le nazisme. Une des premières scènes du film le montre se faisant du mal volontairement et noter dans son cahier les émotions ressenties. Il ne ressent rien et cela s’aggravera au cours de l’histoire. C’est pour ça qu’un lien va se créer entre lui et Baxter, dans le sens où Charles perd les attributs de la culture pour revenir à la bestialité. Toutefois, leur différence est marquée lorsque Baxter refuse de tuer un gosse sous les ordres de Charles, car il n’en voit pas la nécessité. Charles de par sa fascination pour le bull-terrier, va tenter de devenir comme lui et de s’approprier ses souvenirs, devenant même le narrateur du film après la mort de Baxter. Un autre élément montrant sa psychopathie est sa relation avec la fille qu’il aime (et qui ressemble à Eva Braun).
Le film montre la complexité d’êtres différents sur plein de point-de-vue mais qui n’arrivent jamais à se comprendre totalement, chacun ayant ses propres désirs et que personne n’arrive à comprendre. Les rapports de domination sont assez présents, notamment dans la relation Baxter-Charles. Au moment où celle-ci se met en place, Baxter en est heureux car elle repose sur un schéma simple : Charles ordonne, Baxter exécute. Là où auparavant il se demandait son utilité, avec son nouveau maitre il n’a plus à réfléchir mais seulement à obéir, ce qui lui provoque un certain plaisir. Cela démontre un rapport de soumission à la force et la brutalité plutôt qu’à l’amour et aux sentiments. Ce qui par ailleurs jette une parallèle avec l’aspect antisocial et inhumain du nazisme, idéologie que Charles adore.
La perte des sentiments, l’indifférence et la quête d’amour sont les principaux objets du film, que ce soit de la vieille dame, de l’institutrice, de Charles et même de Baxter. A l’instar de cette scène où l’institutrice, qui a une liaison avec le père de Charles, tente de définir l’amour mais maladroitement. Cela s’allie avec la question de la sexualité, plus ou moins refoulé ou étrange. Par exemple, la sexualisation de la jambe de la voisine par Baxter, l’absence de sexualité dans le couple de la vieille dame après la naissance de sa fille qui cherche un substitut en Baxter (elle l’appelle « mon petit homme »), la liaison de l’institutrice ou l’accouplement instinctif de Baxter et d’une chienne.
Cette indifférence générale pour ce que chacun pense est soulignée dans la scène du cimetière où le vieil homme du film vient rendre une dernière visite à la vieille dame, qui était son amie et dont il était le seul à se soucier. Le fantôme de celle-ci apparaît, avec un contraste par rapport à lui : elle en pleine lumière comme venant du paradis et lui dans l’ombre. Elle lui explique que lui qui est si dynamique, plus personne ne cherche à comprendre ce qu’il ressent à son âge, même pas son entourage, et qu’il faut laisser la place aux jeunes (dans le sens mourir) qui ne souhaitent pas apprendre des anciens. Cette perte des sentiments, notamment pour les anciens, engendrent des monstres comme Charles, qui retournent déjà à l’animalité et sont prêt à la barbarie la plus totale.

La totalité du long-métrage amène à l’une des dernières scènes du film, celle de la mort de Baxter. Dans la décharge, Baxter attend Charles suite au meurtre de ses chiots. Alors qu’il a le dessus et qu’il est prêt à tuer l’enfant, celui-ci lui donne l’ordre qu’il a appris (« au pied ») et par instinct, sans pouvoir s’en empêcher, Baxter obéit à Charles, ce qui permet à ce dernier de le tabasser à mort et de le tuer. Outre que cette scène est glaçante, donnant un sentiment de malaise et d’injustice, elle est forte pour la dernière phrase de Baxter : « N’obéissez jamais ». Cela montre l’évolution du personnage, lui qui voulait seulement se soumettre pour ne pas réfléchir. C’est aussi une mise en garde, car Charles étant le résultat de la déshumanisation, l’idéologie de mort qu’il porte et son culte de l’obéissance peut mener aux pires horreurs, comme on en a un bref aperçu lors de ses dernières pensées. C’est une critique de l’obéissance aveugle sans conscience qui pourrait faire penser à une philosophie disons anarcho-individualiste.
Jérôme Boivin a eu un coup de cœur pour le roman dont est issu Baxter, alors qu’il travaillait à l’époque sur un polar plus banal. Il a travaillé sur le scénario avec Jacques Audiard. D’après le réalisateur, cela ne fut pas facile à financer. Il a cherché longtemps une voix pour Baxter, celle-ci devant être un peu mutante, avant de tomber idéalement sur Maxime Leroux, car il savait faire monter les instants dramatiques. Le film a été tourné en Belgique pour des raisons de budget.
Au niveau musical, il y a très peu de partitions dans le film, seulement pour bien marquer l’ambiance, souvent pesante[2]. Pour les images, la plupart des couleurs sont sombres et froides et reflètent les sentiments de Baxter, sauf dans certaines parties où celui-ci est heureux. C’est grâce au travail de la photo d’Yves Angelo qui isole au tout début la couleur dans un décorum plongé dans la grisaille[3].
L’accueil critique fut réservé à sa sortie, de même que commercialement. Le long-métrage a tout de même fait 148000 entrées et a été sélectionné à Avoriaz.
Baxter est un œuvre étrange et qui sied bien à son époque, à ce qui se faisait dans le cinéma de genre français dans les années 80. Il n’y a pas un public visé en particulier à part ceux qui aiment le mélange des genres et les expériences cinématographiques bizarre. Pour conclure, Baxter parle plus que de l’expérience d’un chien qui pense et réfléchit sur le monde des humains de son point-de-vue canin. C’est aussi une allégorie de la lente déshumanisation de la société où les êtres sont incapables de se comprendre et ne peuvent retrouver la paix qu’à travers la domination, amenant à imaginer des horreurs, comme Charles nous invite à le penser en toute fin de film.
[1] Contrairement aux aspects biologiques, les aspects culturels peuvent toujours être perdus !
[2] « What Makes Baxter Great – Baxter (1989) Vidéo Essay », Richard Simon, YouTube, 25/09/2020.
[3] « Baxter », Courte-focale, 16/09/2019.