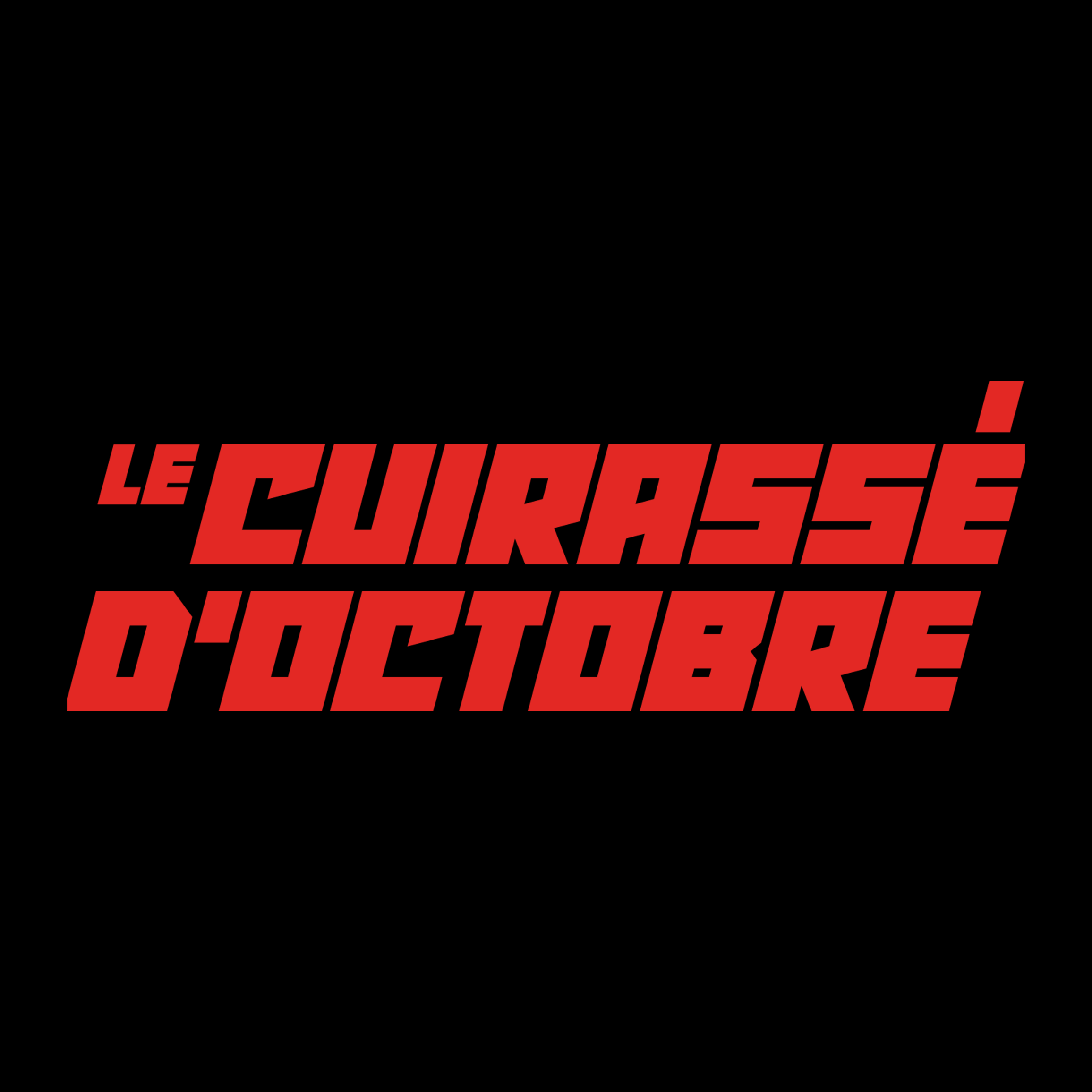Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis réalisateur, ancien photographe et journaliste.
Est-ce qu’il y a une raison particulière qui vous pousse vers le documentaire ?
L’expérience en presse a été importante, surtout que j’y suis resté longtemps. Il y avait déjà un impératif de bouclage, donc une date butoir pour rendre une enquête. En termes d’informations j’ai pu avoir des liens et me renseigner sur tout ce qui était du domaine social ou syndical. Aujourd’hui les journalistes n’ont plus de rapports avec les syndicats, ce qui se ressent sur le fond. Cela donne des articles ou des émissions qui donnent toujours la parole aux mêmes personnes sans laisser parler les travailleurs. L’aspect documentaire permet de traiter davantage le fond. Déjà sans devoir boucler une enquête impérativement à telle date, on a plus le temps de recouper ses sources, quand on est sur les luttes de passer plus de temps avec ceux qui sont en lutte, de faire un travail plus complet et aussi avec un certain recul que l’on obtient que dans la durée. La lutte sociale que j’ai le plus suivie était celle contre la fermeture de l’entreprise Goodyear avec près de 9 ans (1).
Vos documentaires tournent très souvent autour du mouvement ouvrier, de ses luttes, des syndicats et de la répression. Pourquoi ce thème et pas un autre ?
C’est mon thème principal. Il y a au moins deux raisons. La première c’est que je viens d’une famille ouvrière. J’ai grandi dans ce milieu. Plus tard j’ai travaillé à l’usine. J’ai vu la fierté des gens qui y travaillaient et la force d’un syndicalisme puissant. La seconde raison, c’est que vers mes 25-30 ans, j’ai constaté que sur le plan médiatique la question était traitée de manière catastrophique. Dans les médias, il n’y a aucune dénonciation du capitalisme, ni même de recherche sur les causes d’une fermeture d’usine ou pourquoi il y a tel drame social à tel endroit. Ce sont bien des drames dans plusieurs cas. J’ai décidé donc de m’orienter sur ces sujets. Je parle des fermetures d’usines, mais aussi des maladies professionnelles.
Pour moi c’est un peu pareil que pour la Résistance française au nazisme, que j’ai abordé dans beaucoup de mes documentaires. On parle beaucoup de la résistance gaulliste mais jamais de la résistance communiste. Je m’intéresse surtout à la Résistance qui avait un projet politique, celui d’un changement de société, à travers le magnifique programme du Conseil national de la résistance. C’est quelques choses que l’on voit à travers le film Les jours heureux de Gilles Perret. C’est l’histoire de Léon Landini, un grand résistant communiste (2). Je me suis aussi intéressé aux Francs-Tireurs et Partisans de la Main d’œuvre Immigrée qu’on oublie trop souvent dans cette histoire nationale. C’était aussi lez projet politique du PCF de la belle époque, qui malheureusement n’a plus rien à voir maintenant.
Vous avez fait en effet beaucoup de films sur la Résistance française au nazisme.
Oui j’ai réalisé le film sur Julien Lauprêtre (Solidarité, le sens d’une vie, 2017), un autre sur Henri Krasucki (Une jeunesse parisienne en résistance, 2015), sur les FTP-MOI (Les FTP-MOI dans la résistance, 2012) ou sur Madeleine Riffaud (Madeleine Riffaud, la liberté pour horizon, 2020).
Est-ce facile de faire du documentaire en France ? Je veux dire en termes de financement et de distribution des films ?
Pour la production, j’ai trouvé la solution il y a longtemps : c’est le biais de l’autofinancement via la Compagnie ouvrière de production cinématographique. Trouver des personnes pour aider dans la partie technique du documentaire c’est facile. Se faire diffuser à la télévision c’est plus difficile voire impossible, mais on ne doit pas s’arrêter à ça. La diffusion se fait surtout dans les cercles militants et dans certains cas en-dehors, comme pour Urgence soigne et tais–toi.
Il y a un cinéma progressiste en France qui résiste, existe malgré tout, dont vous êtes membre, mais qui est assez peu connu. Avez-vous un avis sur celui-ci ?
C’est difficile d’en faire. Les festivals nous sont fermés, les télévisions aussi. Par contre il n’y a pas de problème à ce que les chaînes financent certains films à des sommes astronomiques. Par exemple France télévision et Arte ont déjà donnés 500000 euros à BHL pour faire des documentaires oubliables et leur faisant perdre de l’argent (3), tandis que les autres n’ont pas le droit au financement et à la diffusion. Pour les festivals, c’est une question politique. Par exemple le festival Filmer le travail n’accepte jamais les documentaires contestataires. Leur réserve doit être sur l’aspect engagé de ces films. Ils dérangent car ils sont trop communisants et trop proches du syndicalisme.
Quels sont vos prochains projets ?
J’en ai plusieurs.
Le premier porte sur Charles Hoareau, qui a été à l’origine de la création des Comités chômeurs, des manifestations pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah et de la lutte pour la libération de la Palestine.
Ensuite, j’en ai un prévu sur Léon Landini.
Enfin, je prépare un documentaire sur Monseigneur Jacques Gaillot, qui s’est engagé dans sa vie dans les luttes sociales, et qui a notamment participé à créer l’association Droits devant !! .
(1) Voir GoodYear, mort de bout de chaîne (2012) et Liquidation (2016).
(2) Son histoire, ainsi que celle de sa famille, est racontée dans le roman Le fil rouge de Gilda Landini-Guibert.
(3) « France télévisions et Arte, grands mécènes du cinéaste Bernard-Henri Lévy », Jamal Henni, Capital, 13/05/2021.